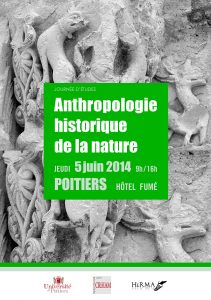• Poitiers, Faculté des Sciences Humaines et Arts, Hôtel Fumé
Présentation
L’anthropologie historique constitue, depuis le milieu des années 1970, l’un des secteurs de recherche les plus dynamiques de la discipline histoire. D’abord centrée sur les périodes médiévale (dans le sillage de Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt) et antique (à la suite de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet), cette réorganisation des problématiques au prisme d’une ethnologie du passé s’est ensuite étendue à toutes les périodes. Les manières de faire, les façons de manger, les modes de gouvernement, les rituels religieux et politiques ont fait l’objet d’analyses serrées et de comparaisons fructueuses.
Parallèlement, l’anthropologie, après une période post-structuraliste dans laquelle la fragmentation en terrains disjoints a pris le pas sur les recherches à visée plus globale, s’est – en partie – réorganisée autour des questions d’arrangements entre nature et culture. Le livre de Philippe Descola, Par delà nature et culture, paru en 2005, constitue une sorte de marqueur historiographique puissant de cette reconfiguration des questionnements.
En proposant cette journée d’études très exploratoire, nous voudrions pointer les zones d’ombre, les espaces interstitiels entre ces grands domaines de recherche. Car si les travaux ne manquent pas sur l’histoire de la nature (comme le montre le dernier numéro de la revue Dix-huitième siècle), l’histoire des animaux (dans la lignée de Robert Delort) ou l’histoire de l’environnement, les investigations nous semblent moins nombreuses sur les implications proprement anthropologiques du rapport de l’homme à la nature. Les recherches anthropologiques, quant à elle, supposent une chronologie relativement plane qui voit tout l’Occident ramené, depuis l’époque moderne, au principe d’une ontologie naturaliste faisant de la césure entre l’homme et son environnement le point de rupture essentiel. Il y a dans l’entre-deux de ces questionnements, matière à approfondir les thématiques, à redéployer des chronotopes plus amples, à diversifier les angles de vue.
Nous avons mobilisé, lors de cette journée d’études, les équipes du Criham et d’HeRMA (mais aussi d’autres laboratoires en France investis dans l’anthropologie historique) afin de tenter une première synthèse exploratoire et multipériodique. Sur un mode très libre d’intervention (études de cas, développements théoriques, balisage historiographique), il s’agirait de croiser les interrogations sur la méthodologie (quelles sources pour une anthropologie historique de la nature ?), les programmes heuristiques (quelle anthropologie historique ? Quelle notion de nature ?), les cadres d’intellection renouvelés (Existe-t-il d’autres ontologies en Occident que le naturalisme ?) et les terrains potentiels de recherche (les rites, les pratiques de savoirs…).